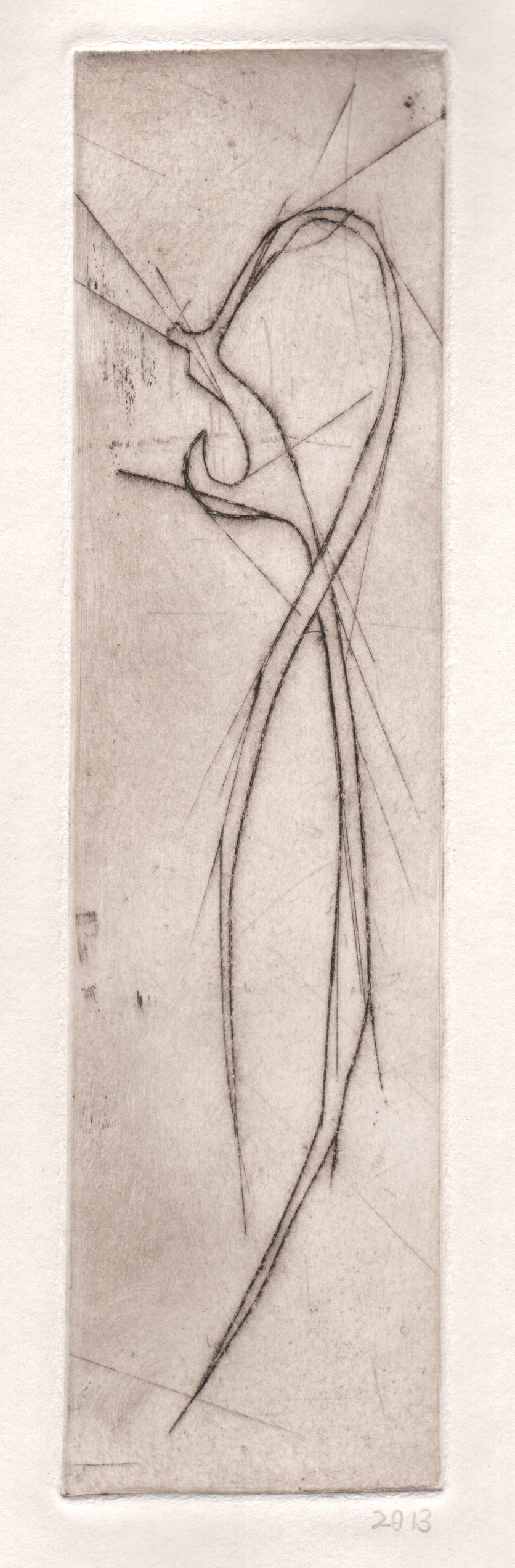Autore
Indice
- Intro
- L’infection de la médecine
- Instinct, langage et vérité
- Prestige et discrédit des proverbes
5. Le vulgaire, le médecin et l’invisible
S&F_n. 13_2015
Abstract
Physicians in early nineteenth century France are repeatedly alarmed about the contemptible persistence of «popular errors» in medicine in spite of the new and definitive trend «observation» and «experience» have imposed to the hole natural sciences. Their mordant critics concern both «vulgar ideas» and «vulgar expressions» which corrupt and dishonour the study of visible facts. But at the same time, and in a very contradictory way, some of them, particularly in the field of medical specialties that have to deal with invisible objects, have recourse to the same «popular» language and conceptions as natural evidences of their conjectures and hypotheses.
- Intro
«S’il est une classe d’hommes dans la société, qui devraient résister à l’influence des opinions populaires, c’est bien certainement celle des médecins. Cependant il n’en est pas ainsi, et l’on aperçoit des traces des idées du vulgaire dans toutes les parties de l’art de guérir»[1]. L’auteur de cette notice alarmante sur la force des «préjugés» en médecine, Vaidy, le très érudit bibliographe du Dictionnaire des sciences médicales, établit ainsi l’urgence d’un partage entre savoir spécifique et opinion commune, et l’extrême difficulté d’effacer dans le premier les vestiges de la seconde. La dénonciation des «erreurs populaires» en médecine a pourtant déjà une longue histoire, depuis Bachot et Joubert, jusqu’à Primerose et Brown. Mais ces livres étaient d’un autre temps: d’«une époque où la philosophie était encore à naître; où les rêves de l’astrologie judiciaire et de l’alchimie occupaient tous les esprits; où l’on croyait généralement aux sorciers, ainsi qu’aux loups-garous; où il eut été dangereux de révoquer en doute l’existence des possédés, et la puissance des exorcismes»; où triomphaient bien d’«autres chimères oubliées aujourd’hui»[2]. Le grand physiologiste Richerand offre alors au public, en 1812, deux ans après la première, la «seconde édition, revue corrigée et augmentée», d’un ouvrage qui ne ressemble à ceux de ces prédécesseurs «que par leur titre», et qui entreprend de traiter:
non seulement des erreurs familières au peuple, mais encore de celles que commet chaque jour le vulgaire des médecins. Par le mot peuple, il faut entendre, et la populace exclusivement vouée par la nécessité au soin de pourvoir à sa subsistance, et avec elle les esprits les plus brillants et les plus cultivés. Ce sont principalement ces derniers qui, abusant des ressources d’une imagination trop active, créent sur ce qu’ils ignorent les hypothèses les moins vraisemblables, et contribuent à propager les plus funestes erreurs[3].
En ce début de XIXe siècle, le renouveau hippocratique est déjà largement engagé, l’abandon des doctrines et des systèmes au profit de l’observation et de l’expérience ne souffre plus guère de contradiction, alors que se maintiennent pourtant dans les esprits et dans le langage, des conceptions et expressions qui trahissent la coupable survivance d’un passé révolu. La rhétorique du blâme est donc de mise, animée par le mépris le plus fort à l’encontre de ceux qui ternissent la «vérité» de la médecine: «Odi profanum vulgus, et arceo» (Je hais la foule profane et je l’écarte), affirmait Horace en épigraphe à la première édition de l’ouvrage de Richerand, avant d’être remplacé, dans la seconde, par un Cicéron moins agressif: «Utinam tam facile vera invenire possim quam falsa convincere» (Heureux, si la vérité me coûtait aussi peu à trouver que le mensonge à détruire). Et la satire médicale des «erreurs» se veut d’autant plus fondée, qu’elle est défensive. Car le profane, dénoncé par la médecine, est lui-même accusateur: «La facilité avec laquelle les esprits vulgaires (et c’est malheureusement le plus grand nombre) adoptent les choses les plus absurdes, est une raison pour qu’ils repoussent les découvertes les plus utiles et les plus salutaires»[4].
- L’infection de la médecine
Vaidy fournit une double explication à ce penchant pour l’absurde, tout en faisant de ce dernier une prolifération morbide: «[…] la médecine est une des sciences les plus infectées d’erreurs, parce qu’elle repose sur une multitude de faits difficiles à observer, et de traditions, pour la plupart inexactes et fausses»[5]. Les deux causes d’infection opèrent évidemment de concert, quoique leur rôle soit distinct: si les «traditions» s’imposent aussi aisément, c’est parce que l’objet de la médecine est tel, qu’il ne permet pas toujours de «combattre l’erreur par l’évidence»[6]. Car cette dernière est parfois inaccessible, ce qui limite strictement le régime de l’«observation», que la médecine se doit d’adopter sur le modèle des «sciences physiques»: «[…] il est presque inutile de dire que le mécanisme intérieur des fonctions organiques, l’action réciproque des solides et des fluides dans le corps vivant, objets insaisissables de raisonnements stériles, doivent à jamais être bannis des observations cliniques, comme ils le sont dans les études régulières des autres sciences physiques; il faut en général s’en tenir aux phénomènes sensibles, c’est à dire aux impressions reçues par la vue, le tact, l’odorat, l’ouïe, etc.»[7]. On comprend que cette exclusion fermement prononcée constitue le seul rempart contre les erreurs du «vulgaire» ou du «vulgaire des médecins», car tout ce qui se dérobe aux sens et dont on voudrait néanmoins affirmer les principes offre justement à la pensée et au langage le milieu le plus propice à la corruption de la science.
Les médecins qui ne savent renoncer aux «raisonnements stériles» sur des «objets insaisissables» ressemblent donc à ceux des malades dont l’«imagination trop active» les pousse à affirmer «les hypothèses les moins vraisemblables»: «nous leurs demandons ce qu’ils sentent, ils nous répondent ce qu’ils pensent; celui-là prétend avoir le sang brûlé ou même calciné, celui-ci soutient que ses nerfs sont crispés, et mille autres absurdités du même genre. Ils ont puisé ces erreurs dans le commerce du monde, elles y circulent librement, et adoptées sans examen, elles règnent sans contradiction»[8]. Les «erreurs populaires» et l’état de maladie sont, de fait, intimement liés, dans la mesure même où à l’altération de la santé correspond une connaissance défaillante: «L’homme souffrant est […] tout crédulité, et il croit, non seulement aux illusions d’autrui, mais encore il regarde les siennes propres comme des réalités»[9]. Ce soupçon qui pèse sur la parole des malades n’est donc pas sans conséquences sur l’exercice de la «médecine clinique». Car ce que ces derniers ressentent, quand ils réussissent à le formuler sans le trahir, constitue le prolongement naturel des «phénomènes sensibles» auxquels l’observateur doit savoir se borner: aux «symptômes objectifs», qui «tombent sous nos sens», se joignent les «symptômes subjectifs», uniquement «révélés par le rapport des malades», auxquels le médecin doit «prêter une oreille attentive»[10]: c’est seulement ainsi que pourront parvenir jusqu’à ses propres sens les sensations du malade. «Mais la plupart des individus sont incapables de rendre un compte exact, de ce qu’ils ont éprouvé et de ce qu’ils ressentent encore. Je ne parle pas de ceux qui délirent, la chose va sans dire; mais je l’entends même de ceux qui ont toute leur connaissance, soit que la maladie leur altère le raisonnement, soit que la douleur exagère leurs maux […]»[11].
- Instinct, langage et vérité
La «narration grossière»[12] que les malades délivrent, aussi nécessaire que suspecte, a d’autant plus de chances de se voir attribuer une valeur, qu’elle émane justement de l’«homme grossier et qui souffre, calme et docile», permettant ainsi «à la nature de le guérir, et au médecin de le seconder»[13]; car ceux qui «jouissent, au contraire, de tous les avantages d’une éducation soignée»[14] sont les plus grands pourvoyeurs de conceptions aberrantes. L’anthropologie médicale sur laquelle s’appuie la dénonciation des «erreurs populaires» fait paradoxalement du «peuple» l’acteur le moins coupable d’«erreurs», préservant ainsi en lui un fond de vérité instinctive et toute animale dans l’expérience pathologique: «Les bêtes ont été les premiers docteurs en médecine, n’en doutons nullement, quand l’histoire médicale ne l’attesterait pas. […] La voix intérieure de l’organisation est si manifeste dans plusieurs maladies, chez les animaux surtout, qu’à cet égard, les ours même nous instruiraient davantage que les gens d’esprit»[15]. Le médecin doit alors être celui qui conserve «bien précieusement cette faculté qui nous identifie avec les souffrances du malade, qui nous fait entrer dans son instinct, et qui nous guide plus sûrement dans la recherche du remède ou des choses convenables, qu’aucune science qu’on puisse jamais apprendre dans les écoles, les amphithéâtres et les bibliothèques. Il serait impossible à un être insensible de faire une médecine qui ait le sens commun, parce qu’il manquerait de l’essentiel ou de tout instinct médical»[16].
La médecine du «sens commun» suppose donc une communauté instinctive. Mais elle permet aussi – ou même appelle – une communauté langagière. Car si les «idées du vulgaire» font que l’«erreur, reçue et transmise, jette chaque jour des racines plus profondes, se perpétue d’âge en âge, acquiert sans cesse une valeur nouvelle»[17], le langage du «vulgaire» n’en est pas moins susceptible de puiser à la source d’une vérité immuable que la médecine retrouve et valide, en même temps qu’elle en retire une légitimité nouvelle. Bichat s’y montre sensible et adresse volontiers au « peuple » la reconnaissance admirative de la science: «Ces expressions vulgaires, le charbon entête, porte à la tête, etc., ne prouvent-elles pas que le premier effet de l’asphyxie que cette substance détermine par sa vapeur porte sur le cerveau et non sur le cœur? Souvent le peuple, qui voit sans le prestige des systèmes, observe mieux que nous, qui ne voyons quelquefois que ce que nous cherchons à apercevoir d’après l’opinion que nous nous sommes préliminairement formée»[18]. Et ce recours à une vérité «populaire» contre l’«erreur» des médecins n’est pas le seul fait de la physiopathologie de Bichat: il tient régulièrement lieu de preuve en médecine, ou d’argument rhétorique, d’autant plus sollicité que la spécialité médicale qui l’accueille repose sur des «faits difficiles à observer» (Vaidy). La psychiatrie en est largement bénéficiaire, elle aussi, dès lors qu’elle se risque, au-delà de l’observation des symptômes, à désigner les lieux où s’origine la folie dans le corps. Ainsi fait Jean-Pierre Falret: «Dans cet ouvrage, je m’attache surtout à démontrer que l’opinion du peuple sur le siège de la folie est mieux fondée que celle des médecins en général»[19]. Et les exemples viennent aussitôt à l’appui: «Les expressions de tête folle, de cerveau vide, embarrassé, brûlé, de malades de tête, d’esprit, et autres semblables qui lui sont habituelles pour caractériser les aliénés, indiquent d’une manière assez positive la source du mal. L’énergie de quelques-unes de ces expressions en fait même présager la nature»[20]. Si donc le «sang brûlé» enrichit le répertoire des «absurdités» recensées par Richerand, le «cerveau brûlé», lui, compte parmi les «expressions» énergiques qui font «présager la nature» de la maladie.
Falret avait été précédé par Georget, attaché comme lui à faire admettre le siège cérébral de la folie et rassemblant, pour le coup, dans une même intuition le «peuple» et les médecins: «Nous trouverons quelques raisons en faveur de nos opinions dans les dénominations diverses employées par les auteurs et le vulgaire, pour désigner cette maladie et ceux qui en sont atteints, dans les sensations qu’éprouvent et dont se plaignent les aliénés. Les expressions de maladie mentale ou de l’esprit, aliénation mentale, folie, manie, démence, etc., ont rapport au cerveau. On dit des fous, qu’ils ont perdu la tête ou la raison, qu’ils sont malades de tête, que leur esprit est égaré, etc. Beaucoup de ces malades se plaignent d’avoir la tête malade ou mal à la tête, l’esprit ou la tête faibles, des absences d’esprit, le cerveau vide, le cerveau embarrassé, et toujours en portant la main vers cette partie, surtout du côté du front»[21]. Moreau de Tours recourra au même argument, mais avec le dessein de démontrer, lui, l’identité des états de rêve et de folie: «De tout temps, le langage vulgaire a consacré cette vérité, en appliquant particulièrement aux aliénés dominés par des idées fixes, la désignation de rêveurs!»[22]. Quant à Guislain, il est résolument opposé, dans ses thèses, à Georget, Falret et Moreau de Tours: «Je désire combattre une idée généralement accréditée, à savoir que la maladie mentale, de son essence, est une affection du domaine de ce qu’on nomme vulgairement l’esprit. Je vais m’attacher à vous démontrer que, dans le plus grand nombre des cas, c’est par le cœur et non par l’esprit que l’aliénation s’établit dans le moral de l’homme»[23]. Mais sa démonstration engage, comme pour ses prédécesseurs, un examen des ressources expressives du langage:
Ce qui vous paraîtra sans doute étrange, c’est que dans l’idiome dont nous nous servons pour traduire notre pensée, nous ne trouvions pas un substantif qui désigne cette nature impressionnable de notre moral […]. L’attribut en question est toujours indiqué par des locutions ayant trait à des phénomènes qui ne sont pas ceux qu’il importe de constater. Cette remarque justifie l’assertion de Pinel, qui prétend que la langue française est peu riche pour exprimer les diverses nuances des vésanies.
Les races germaniques possèdent le mot en question.
L’allemand a le Gemüth.
La langue flamande, la langue hollandaise ont l’équivalent de ce mot, le Gemoed.
Les Anglais le confondent généralement avec moral.
C’est pour ainsi dire l’Animus des Romains, le Thumos des Grecs.
C’est presque le Cœur dans son acception morale: on dit avoir du cœur, avoir un cœur compatissant, un cœur sensible, un cœur navré, un cœur moral, ne pas avoir de cœur, ne pas avoir d’entrailles, être un homme sans cœur[24].
Déçu de sa propre langue, Guislain se voit contraint, pour «traduire» sa «pensée», d’en adopter une autre ou de réhabiliter, dans la sienne, un mot commun, en s’autorisant d’expressions figées et de sentences populaires. Et sa démonstration est complétée par l’énumération des circonstances, non moins communes, dans lesquelles le «Gemüth» se manifeste en lui apportant une confirmation expérimentale définitive: «J’éprouve dans toutes ces situations je ne sais quel frémissement d’entrailles, quelle strangulation de la gorge, quelle sensibilité dans les yeux, quel serrement de cœur, quelle commotion intérieure vive et profonde, qui retentit dans ce que l’on nomme le centre phrénique. C’est pour cela que Carus a eu raison de dire que Herz et Müth sont synonymes»[25]. Comme ses malades, qui «rapportent» au «cœur» ce «sentiment» si «difficile à décrire», le médecin ressent dans ses «entrailles» quelque chose qu’il nomme – avec non moins d’imprécision qu’eux, mais sans s’en inquiéter – un «serrement de cœur». En quoi Guislain et Moreau de Tours se rejoignent, non dans leurs conceptions de la folie, diamétralement opposées, mais dans le rapport qu’ils établissent tous deux entre expérience, langage et connaissance. Car après avoir éprouvé lui-même, sinon la folie, du moins l’état parfaitement analogue que lui paraissent offrir le rêve ou le délire haschischin, Moreau de Tours évalue chacun des mots et des tournures, y compris les plus communs, qui désignent le trouble morbide avec le plus d’exactitude: «on est comme abasourdi, on ne sait plus ce que l’on fait, on perd momentanément la conscience de soi-même, on ne se connaît plus […]. Toutes ces locutions consacrées par le langage vulgaire traduisent avec vérité l’état dans lequel se trouve la machine intellectuelle lorsqu’elle est puissamment ébranlée par les passions»[26]. Alors même qu’on le déclare dépositaire des «erreurs» que la médecine a pour mission d’«extirper»[27], le «langage vulgaire» devient facteur de «vérité», d’autant plus fondé dans ce rôle que le médecin lui-même le parle, en occupant du coup la place du malade, sans abandonner pour autant ses prérogatives de savant.
- Prestige et discrédit des proverbes
La médecine n’est certes pas portée à accorder pareille confiance à la sagesse populaire: «Toujours dans un pays civilisé, les lumières seront l’apanage du petit nombre, comme dans une réunion quelconque le savoir, la sagesse, la raison, en un mot tout ce que le cœur humain renferme de plus noble, appartient constamment à une minorité, dont les efforts généreux ne sont que trop souvent impuissants pour contrebalancer l’influence de l’ignorance, des préjugés et des passions»[28]. C’est bien d’ailleurs à ces «efforts généreux» que s’attèlent ceux qui écrivent et récrivent «l’inépuisable chapitre des erreurs populaires qui déparent la médecine»[29]. Et s’il est un «proverbe sage comme le sont toutes les maximes populaires», qui «dit: vox populi, vox Dei», il faut décidément admettre que les «maximes populaires», indûment vantées, sont en réalité dépourvues de sagesse, et que les médecins doivent impérativement montrer «plus de sagacité que l’inventeur de ce dicton»[30] et renoncer à la raison fallacieuse d’un argumentum ad populum.
Sévère arbitre du conflit entre erreur et vérité, Richerand en vient pourtant lui-même à réhabiliter les sentences vulgaires en leur attribuant une valeur parfois dissimulée: «Tous les proverbes populaires relatifs à la médecine sont loin de consacrer des erreurs; la plupart renferment un sens profond et vrai caché sous une expression triviale»[31]. La reconnaissance est certes ambiguë: la vérité des proverbes est cachée, alors que, formulée par le peuple et à son principal usage, elle devrait se manifester au plus grand nombre; et si «tous» les proverbes ne sont pas faux, ce qui fait de leur vérité une exception, «la plupart» sont vrais, ce qui renverse la proportion. Adresse ou maladresse argumentative, cette hésitation fait signe du retournement opéré par Richerand qui, après avoir timidement reconnu dans la première édition de son livre que «le vulgaire, quoique soumis à l’erreur, voit quelquefois juste»[32], consacre deux chapitres abondants, dans la seconde édition, au recensement de «quelques proverbes relatifs à la Physiologie» et «à l’Hygiène»: «avoir du cœur», «être une mâchoire», «avoir un col de grue» ; «il n’est sauce que d’appétit», «ce qui est amer à la bouche est doux au cœur», «il n’est pire eau que l’eau qui dort», et bien d’autres encore, qui, pour être quelquefois énigmatiques, ne lui semblent pas moins lestés d’une vérité incontestable qu’il s’applique à longuement démontrer dans un élan médico-philologique.
- Le vulgaire, le médecin et l’invisible
Mais au-delà des seuls proverbes et sentences, dont d’autres que Richerand se plaisent aussi, avec non moins de circonvolutions rhétoriques, à établir le florilège, en se bornant principalement à l’hygiène[33], c’est plus fondamentalement la question du recours au «langage vulgaire» comme dispositif de preuve qui se pose à la médecine, en lien avec la nature des objets que celle-ci doit faire siens, et donc avec le mode de connaissance qu’elle est conduite à engager: physiologie et psychiatrie, particulièrement concernées, ont en commun, quoiqu’elles se soumettent au régime de l’«observation», un mode hypothétique et conjectural qui fait la part belle au ressenti et à l’expression. Les recommandations de Pinel à l’aube du siècle sont pourtant univoques: «On doit espérer que la médecine philosophique fera désormais proscrire ces expressions vagues et inexactes d’images tracées dans le cerveau, d’impulsion inégale du sang dans les différentes parties de ce viscère, du mouvement irrégulier des esprits animaux, etc., expressions qu’on trouve encore dans les meilleurs ouvrages sur l’entendement humain […]»[34]. Mais si son exhortation rencontre l’assentiment de tous, elle appelle aussi des nuances: «Ces expressions de traces faites dans le cerveau, de fibres mises en mouvement, et autres semblables, sont purement hypothétiques, il faut en convenir: mais elles servent à rendre sensibles nos conjectures sur le mécanisme des fonctions intellectuelles: on ne peut en substituer d’autres qu’en changeant d’hypothèses»[35]. C’est dire que les «expressions vagues et inexactes» figurant au catalogue des «erreurs populaires», peuvent être investies d’une valeur au moins didactique, sinon épistémologique, et que les médecins qui les profèrent tiennent le «langage du vulgaire», au risque de ressembler au «vulgaire des médecins», et à leurs propres malades.
Mais la possibilité de cette inversion de valeurs tient aussi au sens et à l’extension variables des termes qui désignent, non les faits ou conjectures de la physiologie et de la pathologie, mais la qualité même du «langage» dans lequel ils s’énoncent. «Ordinaire» ou «vulgaire», ce dernier s’oppose au «langage médical», dont la spécificité problématique pousse les médecins, contradictoirement, à regretter d’une part l’insuffisance des mots communs, auxquels la médecine devrait trouver des substituts, et à dénoncer d’autre part les dérives du «néologisme» qui, de «savantes synonymies» en «riches nomenclatures tirées avec effort d’une langue morte», entraînent peu à peu la «corruption du langage»[36]. Mais au-delà de son opposition avec «médical» ou «savant», qui supposent tous deux la maîtrise d’un savoir spécifique, «vulgaire» indique une appartenance sociale et implique une échelle de valeurs: le «vulgaire», dans son emploi nominal, désigne non seulement le profane, mais aussi le «peuple». Le «langage vulgaire» est donc à la fois celui de tous et celui des non-médecins, en même temps que, frappé d’une nuance dépréciative, il est celui d’un seul groupe dont les médecins stigmatisent parfois l’insuffisance verbale: «Il faut avoir fait la médecine dans les hôpitaux pour savoir jusqu’où peut aller la stupidité des dernières classes de la société, lorsqu’il s’agit de rendre compte de leurs maladies […]»[37]. L’adjectif «vulgaire» est donc proche, en ce sens, de «populaire», mais sans nécessairement se confondre avec lui, car s’il y a une «médecine populaire», il n’existe pas de médecine «vulgaire», sans doute parce que les «erreurs populaires» en médecine, si elles sont le fait du «peuple», en vertu de traditions obscures et de «l’assurance avec laquelle chacun raisonne de la nature des maladies, de la propriété des remèdes»[38], elles trouvent plus sûrement encore leur source dans «la lecture de quelques traités de médecine populaire», dont certains sont même «dus à des médecins recommandables»[39].
La «médecine populaire» n’est donc telle que parce qu’elle s’adresse au «peuple» et non parce qu’elle émane de lui, quoique l’«erreur populaire» lui soit imputée, alors même qu’elle consiste à croire aux promesses de ces livres et d’en répéter la leçon, ce que font les malades, parfois avec une maladresse vertement sanctionnée: «Ceux qui ont parcouru quelques livres de médecine populaire, vous décrivent en style médical les phénomènes qu’ils éprouvent, en estropiant souvent les mots et les choses de la manière la plus risible»[40]. Si donc la médecine a pour charge de «détromper une foule de gens trop crédules»[41], elle doit cette pénible mission autant à la puissance du «charlatanisme» qu’à la responsabilité de ceux des médecins qui «sont eux-mêmes inexcusables d’avoir eu la prétention de mettre à la portée du peuple les difficultés de leur art», sans avoir assurément «réfléchi sur les dangers d’une semblable communication»[42]. Le «peuple» et le «vulgaire», dans les «erreurs» qu’ils commettent en matière de médecine, ne sont donc jamais totalement «populaires», mais toujours aussi un peu médecins: à la fois trop et pas assez, représentants malgré eux d’une médecine d’un autre temps, ou qui devrait l’être. Célébrer l’«opinion du peuple» (Falret) et la valeur des «locutions consacrées par le langage vulgaire» (Moreau de Tours), reconnaître en elles un savoir qui légitime la science, cela revient donc simultanément à les supposer libres de tout dépôt médical, ancien ou moderne, et à leur attribuer le privilège d’une connaissance naturelle qui se déploie, comme idéalement en médecine, à travers le seul exercice des sens. C’est à cette double condition que le médecin partage avec le «peuple» la sagesse anonyme des «expressions» qui appartiennent à tous et donc à lui-même. Vox populi, vox medici.
Il n’est pas indifférent que ce soit un écrivain romantique, Charles Nodier, qui féru de médecine et de langage, ami de nombreux médecins et largement cité par eux, énonce le principe sur lequel repose cette équivalence de voix: «Toutes les fois qu’une manière de parler s’est naturalisée dans le langage au point d’être intelligible à tous sous sa forme figurée, il est évident qu’elle remonte à la même origine pour tous, dans la sensation»[43]. Car c’est bien une conception romantique du langage dans son rapport à la science, qui se fait jour dans cette dérive qui conduit la médecine, de la recherche exclusive d’une «évidence» purement observable, et aussitôt mobilisée contre les «erreurs populaires», à l’adoption de la «forme figurée», dans les «expressions» du «vulgaire», comme gage authentique d’une «vérité» invisible.
[1] J. V. F. Vaidy, Préjugés (des médecins), in Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et de chirurgiens, C.L.F. Panckoucke-Crapart-Le Normant, puis C.L.F. Panckoucke, Paris 1812-1822 [désormais DSM], t. XLV (1820), pp. 52-53.
[2] B. A. de Richerand, Des erreurs populaires relatives à la médecine, Caille et Ravier, Paris 1812, pp. VII et 5.
[3] Ibid., p. 1.
[4] L-J. Renauldin, Erreurs populaires sur la médecine, in DSM, t. XIII (1815), p. 209.
[5] J. V. F. Vaidy, Préjugés (des médecins), cit., p. 46. Voir aussi L.-J. Renauldin: «Parcourez le cercle entier de l’art de guérir, vous en trouverez toutes les parties infectées d’erreurs populaires» (op. cit., p. 200); et B. A. de Richerand: «Entreprendre d’extirper les erreurs dont certaines sciences se trouvent infectées, ce serait en essayer la complète réfutation. Des plaisants diront peut-être que la médecine est de ce nombre» (op. cit., p. 7).
[6] B. A. de Richerand, op. cit., p. 5.
[7] Ph. Pinel, I. Bricheteau, Observation (histoire des maladies), in DSM, t. XXXVII (1819), p. 29.
[8] B. A. de Richerand, op. cit., pp. 2-3.
[9] F.-E. Fodéré, Malade, in DSM, t. XXX (1818), p. 164.
[10] J. Frank, Introduction à l’étude de la médecine clinique, Pathologie médicale, in Alibert et alii, Encyclopédie des sciences médicales; ou traité général, méthodique et complet des diverses branches de l’art de guérir, deuxième division, Médecine, Bureau de l’Encyclopédie, Paris 1835, p. 73.
[11] F.-V. Mérat, Interrogation (des malades), in DSM, t. XXV (1818), p. 524.
[12] J. Frank, op. cit., p. 74.
[13] B. A. de Richerand, op. cit., p. 2.
[14] Ibid.
[15] J.-J. Virey, Instinct, in DSM, t. XXV (1818), p. 369.
[16] Ibid., pp. 368-369.
[17] B. A. de Richerand, op. cit., p. 3.
[18] M. F. X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Brosson, Gabon et Cie, Paris an VIII (1800), p. 232.
[19] J.-P. Falret, De l’hypochondrie et du suicide, considérations sur les causes, sur le siège et le traitement de ces maladies, sur les moyens d’en arrêter les progrès, Croullebois, Paris 1822, p. VII.
[20] Ibid.
[21] É.-J. Georget, De la folie: considérations sur cette maladie; suivies de Recherches cadavériques, A. Crevot, Paris 1820, p. 80.
[22] J.-J. Moreau de Tours, Du Hachisch et de l’aliénation mentale. Études psychologiques, Fortin, Masson et Cie, Paris 1845, pp. 122-123.
[23] J. Guislain, Leçons orales sur les phrénopathies, ou traité théorique et pratique des maladies mentales. Cours donné à la clinique des Établissements d’aliénés à Gand, L. Hebbelynck-J.-B. Baillière-Ad. Marcus, Gand-Paris-Bonn 1852, t. II, p. 115.
[24] Ibid., p. 123.
[25] Ibid., p. 125.
[26] J.-J. Moreau de Tours, op. cit., p. 213.
[27] B. A. de Richerand, op. cit., p. 7.
[28] Jugement, in Dictionnaire abrégé des sciences médicales, par une partie des collaborateurs, Panckoucke, Paris 1821-1826; t. X (1824), p. 294.
[29] L.-J. Renauldin, op. cit., p. 221.
[30] Jugement, op. cit., p. 294.
[31] B. A. de Richerand, op. cit., p. 247.
[32] B. A. de Richerand, Des erreurs populaires relatives à la médecine, Caille et Ravier, Paris 1810, p. 168.
[33] Voir notamment : G. M. Couhé, Essai sur quelques Expressions proverbiales et Sentences populaires relatives à la Médecine, Didot Jeune, Paris 1808 ; I. Bricheteau, Proverbes (en médecine), in DSM, t. XLV (1820), pp. 514-517.
[34] Ph. Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie, Richard, Caille et Ravier, Paris an IX [1800], p. 25.
[35] A. Matthey, Nouvelles recherches sur les maladies de l’esprit, précédées de Considérations sur les difficultés de l’art de guérir, J.-J. Paschoud, Genève 1816, p. 160.
[36] J. F. Delpit, Néologisme, in DSM, t. XXXV (1819), pp. 442 et 443.
[37] F.-V. Mérat, op. cit., p. 525.
[38] J. F. Delpit, Populaire (médecine), in DSM, t. XLIV (1820), p. 292.
[39]Ibid., p. 294.
[40] F.-V. Mérat, op. cit., p. 525.
[41] B. A. Richerand, Des erreurs populaires relatives à la médecine, Caille et Ravier, Paris 1812, p. VI.
[42] L.-J. Renauldin, op. cit., p. 219.
[43] Ch. Nodier, Des hallucinations et des songes en matière criminelle (1835), in De quelques phénomènes du sommeil, édition présentée par E. Dazin, Le Castor Astral, coll. Les Inattendus, Bègles 1996, p. 81